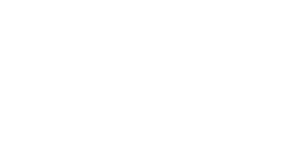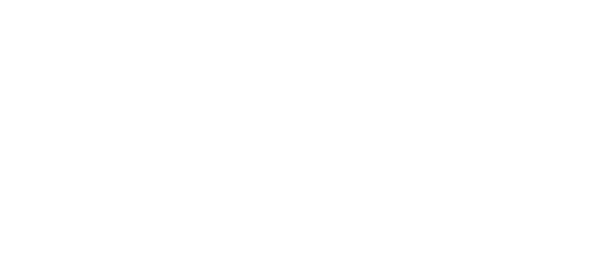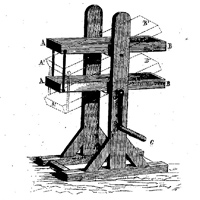Journées scientifiques en Minervois 2022
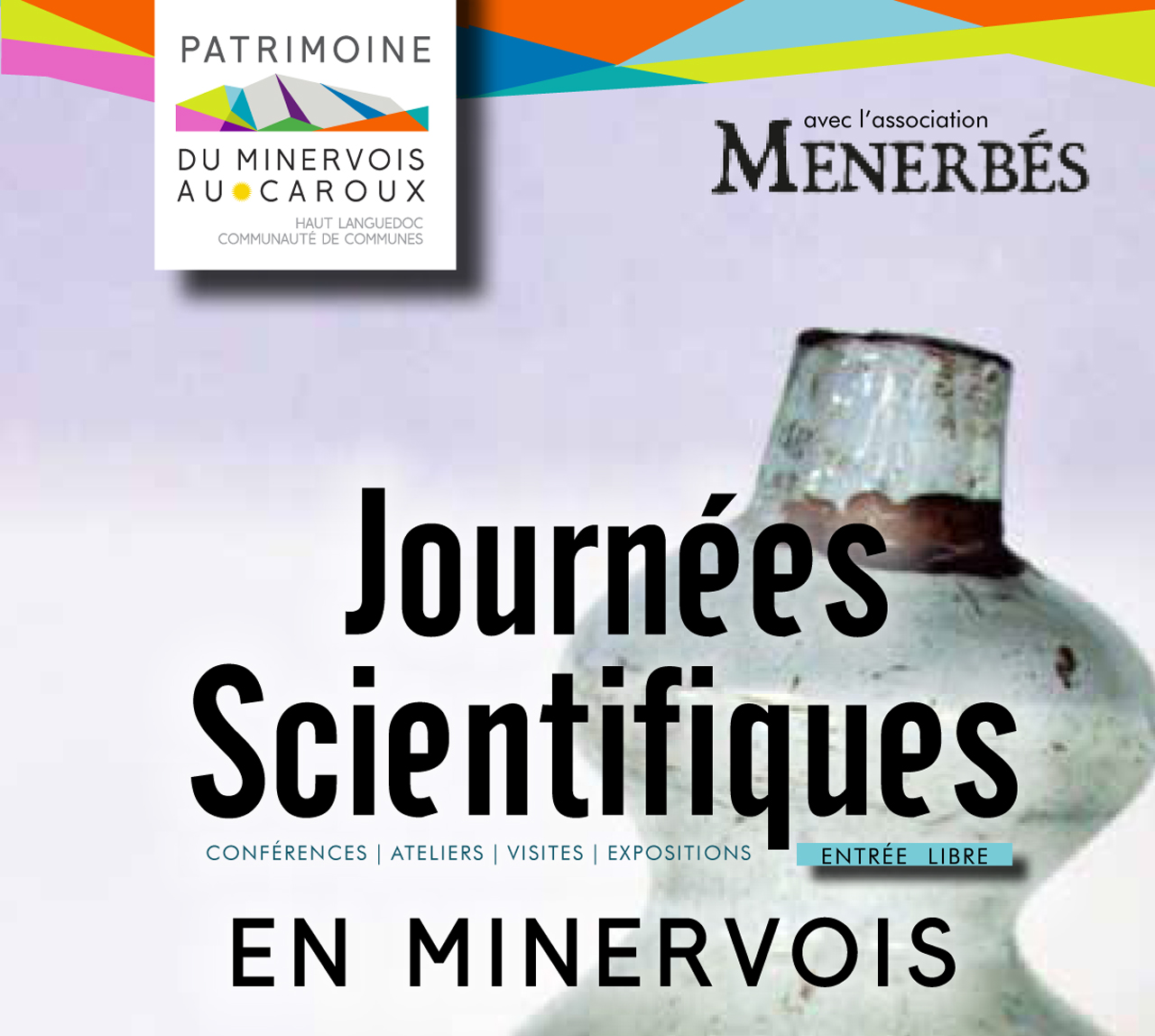
Journées scientifiques en Minervois
Conférence aux Journées scientifiques en Minervois 2022.
A l’occasion des 6ème Journées scientifiques en Minervois organisées par la communauté de commune du Minervois au Caroux, j’ai tenu une conférence le Dimanche 13 Novembre 2022, en voici le résumé…
Le verre Mousseline Premier vitrage décoratif industrialisé.
Par Christian Fournié verrier décorateur. Maître artisan en métiers d’art.
Introduction :
Le verre mousseline, est un verre à vitre émaillé à chaud sur lequel est imprimé un décor constitué de motifs répétitifs inspirés des dentelles et rideaux d’où son nom « mousseline ». Première citation écrite en 1836 dans un rapport sur les arts chimiques en France. Au départ artisanal il s’agit en fait du premier vitrage décoratif industrialisé. On peut diviser son histoire en 4 actes : L’invention, les fabricants, le déclin et le mousselinage.
L’invention :
Pour simplifier, la fabrication du verre mousseline entre en scène avec un brevet principal déposé par le chimiste Dumas et le peintre verrier Godard à Lyon en 1841. Ce brevet fixe d’abord la composition chimique d’une peinture vitrifiable nommée encore aujourd’hui émail ou grisaille mousseline. Ensuite ce même brevet décrit un procédé décoratif très simple d’enlèvement d’émail avant cuisson à l’aide d’un pochoir rigide et d’une brosse.
Cette innovation répond alors à un besoin d’intimité pour l’intérieur des demeures. Très décoratif, le verre mousseline permet de garder de la lumière et de cacher plus ou moins la vue suivant les modèles, tulles, classiques ou mats.
Grace aux progrès du chimiste Dumas dans les fabrications d’émaux vitrifiables et des verres de couleurs du verrier Bontemps, le vitrail devient une véritable industrie en France à partir de 1826. D’abord réservé à l’art religieux, la demande se tourne ensuite également vers la réalisation, de vitraux décoratifs dit « civil ». C’est dans ce contexte florissant que le verre mousseline s’inscrit pleinement.
Les Fabricants.
Entre 1836 et 1942 les fabricants se succèdent. En quelques dizaines d’années on passe des peintres verriers du début comme Georges Bontemps à Choisy le roi ou Laurent et Cie à Paris en 1843, aux verreries industrielles de la fin du 19ème siècle. Celles ci qui produisent alors des milliers de mètres carrés de verres mousselines. Les modèles se résument alors à une vingtaine et sont tous issus des centaines de modèles édités par l’atelier de Louis Napoléon Gugnon peintre verrier originaire de Metz . Les verres mousselines seront aussi déclinés en reliefs et en couleurs par la famille Picard sur près de 4 générations entre 1872 et 1942 avec des procédés de fabrications originaux.
Le déclin :
Il commence dès 1892 avec les fabrications de verres imprimés à reliefs d’inspiration « Art-Nouveau » par St-Gobain. Ces vitrages décoratifs plus grands plus épais plus dans l’air du temps signent la fin du verre mousseline. De plus à partir de 1920 la fabrication du verre plat évolue. Le verre n’est plus soufflé, mais étiré verticalement (Procédé Fourcault). Le verre mousseline émaillé à chaud est alors remplacé par ce que l’on appelle le « mousselinage » dans les verreries industrielles.
Le Mousselinage :
Ce terme se retrouve sur un catalogue St-Gobain Chauny et Cirey dès 1898. Il s’agit d’un métier artisanal qui reprend tous les codes du verre mousseline en termes esthétiques et graphiques. Il s’agit alors de les appliquer sur d’autre types de vitrages plus épais et plus grand à l’aide d’autres techniques à froid comme la gravure à l’acide, ou le sablage. En 1910 L’ingénieur Allemand Gutmann conçoit même une machine de sablage dédié au mousselinage. En 1920 l’atelier de Charles Gaston Picard s’installe rue Pascal à Paris. Il sera un des derniers à mousseliner du verre jusqu’en 1942.
En Conclusion :
le verre mousseline à existé sur près d’un siècle, traversant les styles décoratifs de la restauration jusqu’à l’Art-déco. Son succès est exemplaire dans la mesure ou il est né d’un réel besoin auquel les verriers de l’époque ont su répondre en innovant aux fils des années dans une longue transmission. Comme toute production industrielle le verre mousseline a un début, une apogée, et un déclin. Il devient désuet après 1950. Ensuite s’installe ce que j’appelle une distance temporelle entre sa disparition et le moment ou on commence à s’apercevoir qu’il manque. Ce vitrage fait partie de notre patrimoine à présent et plus que jamais :
« Ne jetez pas vos vitrages anciens, ils ont une histoire … »
Remerciements
Merci à l’équipe de l’office de tourisme et la communauté de communes du Minervois Caroux pour leurs oganisations lors de cette manifestation. Merci également à la Mairie de Siran pour l’accueil dans leurs locaux très bien adaptés et équipés.
C. Fournié Nov.2022
- Page Officielle : 6ème Journées scientifiques en Minervois
- Communauté de communes Du Minervois au Caroux
- Office de tourisme : Minervois-Caroux